Les trois lois constitutionnelles de 1875 sont pensées dans un contexte politique et institutionnel singulier. En effet, après la chute du Second Empire et la proclamation de la République le 4 septembre 1870, l’Assemblée nationale constituante chargée d’organiser les institutions provisoires de l’État, qui siège à Bordeaux puis Versailles, ne parvient pas à remplir sa mission. Le projet de la majorité – le rétablissement de la monarchie – échoue en raison de la fracture entre légitimistes et orléanistes. Une incertitude constitutionnelle s’installe jusqu’en 1875.
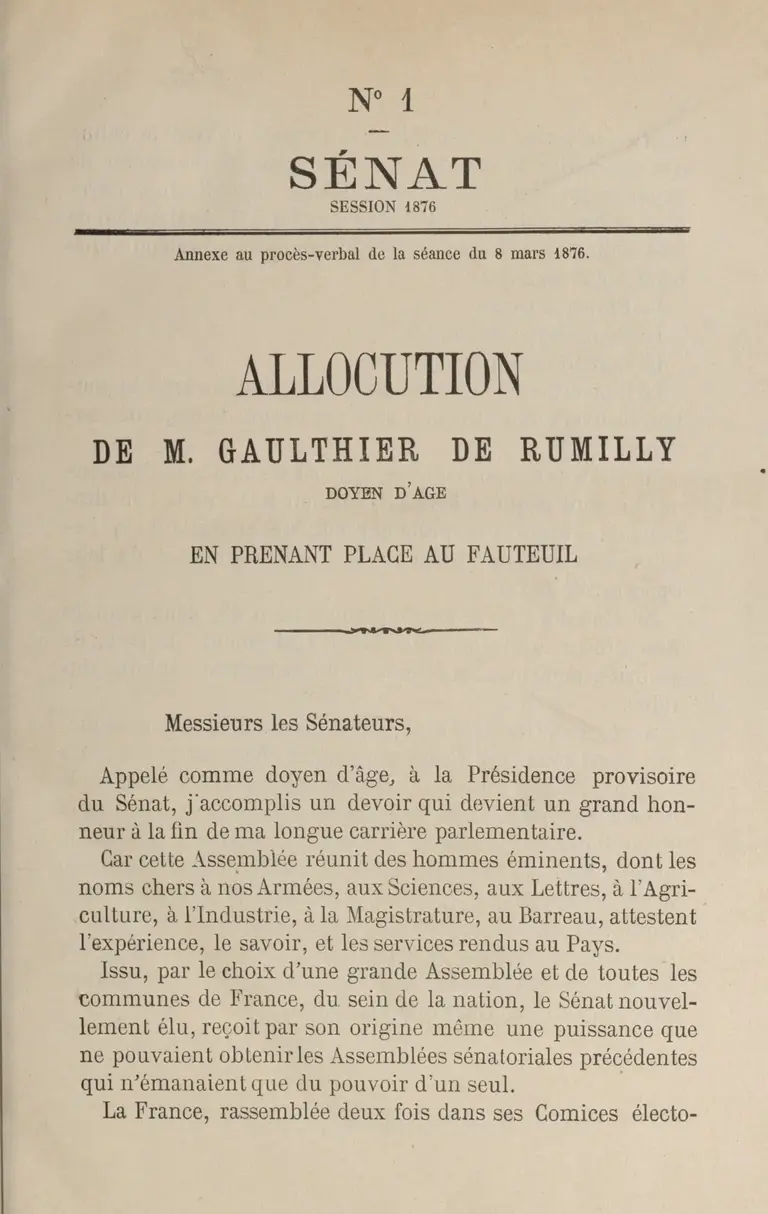
Première allocution du Sénat de la IIIe République - © gallica.bnf.fr / Bibliothèque du Sénat
A la tête du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers ne remet pas en cause le caractère républicain du régime proclamé en 1870, ce qui contribue à l’installer. Il choisit, dans un second temps, d’en défendre le principe. La répression de la Commune de Paris démontre par ailleurs que tous les républicains ne sont pas révolutionnaires ; leur pragmatisme rassure.
Après la démission de Thiers en mai 1873, les excès de la politique de restauration de « l’ordre moral » poussent les républicains à « sortir du provisoire » et « organiser la République », alors que les monarchistes se divisent entre les partisans du Comte de Chambord et les orléanistes déçus de son intransigeance (refus du drapeau tricolore, …).
Le succès de députés bonapartistes lors d’élections partielles amène un changement d’équilibre politique, alors que les idées républicaines gagnent du terrain. La crainte d’un retour des bonapartistes incite républicains et orléanistes à se rapprocher.
Les trois lois constitutionnelles de 1875 qui fondent institutionnellement la IIIème République sont donc l’aboutissement d’un travail de compromis acharné, construit article par article, par des forces politiques obligées de composer. Brefs, techniques, leurs articles organisent la pratique du régime politique de la IIIème République sur les bases d’un parlementarisme bicaméral, sans jamais faire référence à un préambule, une déclaration de principe ou des références philosophiques qui pourraient être clivantes et nuire à l’indispensable esprit de compromis.
Les lois constitutionnelles sont votées respectivement le 24 février 1875 (l’organisation du Sénat), le 25 février 1875 (l’organisation des pouvoirs publics) et le 16 juillet 1875 (les rapports entre les pouvoirs publics).
Le 6 janvier 1875 les débats sur la loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics commencent. Aucun compromis ne se dégage avant l’amendement « Wallon », du nom de son auteur le député puis sénateur du Nord Henri Wallon. Son texte, « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. » est adopté à une voix près le 30 janvier 1875. Les grands principes qui sous-tendent le nouveau régime figurent dans cet article : République, bicamérisme, septennat. Il devient l’article 2 de la loi du 25 février 1875.
Avant même la loi sur les pouvoirs publics, la loi sur l’organisation du Sénat est donc votée le 24 février 1875. Première des lois constitutionnelles, elle concerne la Chambre haute, gardienne de l’équilibre institutionnel. Le Sénat est l’objet de tractations entre républicains et orléanistes. Les premiers sont partisans d’une assemblée unique pour incarner la volonté de la nation et inscrire la République dans la Constitution. Les monarchistes, de leur côté, tiennent au bicamérisme pour contrebalancer une assemblée trop démocratique selon leurs vues, d’autant qu’ils persistent dans l’idée d’un prochain rétablissement de la monarchie. Entraînés par Léon Gambetta, les républicains comprennent que les monarchistes sont prêts à céder sur l’instauration de la République dès lors que l’idée d’un Sénat leur donne satisfaction. Gambetta défend aussi l’idée que ce « Grand Conseil des communes françaises » enracinera la République dans les campagnes.
Le Sénat créé par les lois des 24 février et 16 juillet 1875 reflète ce compromis : conçu comme une digue contre les excès démocratiques, 75 des 300 membres qu’il compte sont nommés à vie et inamovibles, les 225 autres sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral départemental constitué de députés, conseillers généraux, conseillers d’arrondissement et de délégués sénatoriaux élus par les conseils municipaux. Âgés de 40 ans au moins, les sénateurs sont élus pour neuf ans et renouvelés par tiers tous les trois ans.
Les missions des sénateurs sont identiques à celles des députés : initiative des lois, élection du Président de la République et révisions constitutionnelles. En revanche, le Sénat ne peut être dissous mais son avis conforme est indispensable pour prononcer la dissolution de la Chambre des députés. Il peut être constitué en Haute Cour de justice pour juger le Président de la République et les ministres en cas d’attentat à la sûreté de l’État.
Quelques mois sont nécessaires à la mise en place des nouvelles institutions. La première séance du Sénat se tient le 8 mars 1876.