L’adoption de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, qui a nécessité de longues heures de débat, fut le fruit d’un important travail préparatoire. Le Sénat a joué un rôle majeur dans la simplification de la rédaction du texte que le garde des Sceaux Jean LECANUET, avait déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 9 août 1976.
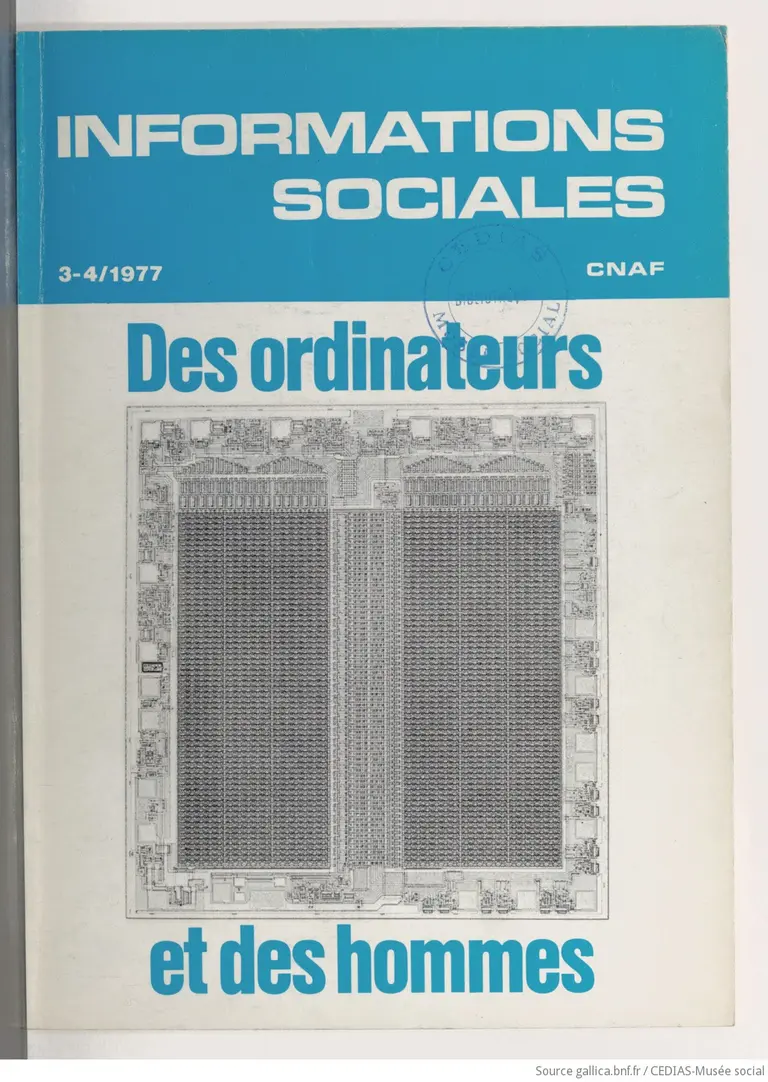
Rapport n° 72 (1977-1978) de M. Jacques THYRAUD, fait au nom de la commission des lois, déposé le 10 novembre 1977
Au Sénat, le rapport est confié à Jacques THYRAUD, sénateur centriste du Loir-et-Cher, au nom de la commission des Lois. « Telle la langue d’Ésope, l’informatique peut être la meilleure comme la pire des choses ». Par ces mots le sénateur introduit une réflexion sur une technique si nouvelle qu’elle suscite de nombreuses questions d’ordre aussi bien éthique, juridique que technologique. Le travail avait été amorcé à l’initiative du Conseil d’État dès 1969 et s’était poursuivi sous la houlette de Bernard TRICOT, rapporteur de la Commission informatique et libertés mise en place par Pierre MESSMER, alors Premier ministre.
La portée du rapport TRICOT fut renforcée par la proposition de loi, déposée en 1974 par le sénateur Henri CAILLAVET, tendant à créer un directoire et un tribunal de l’informatique. Ce texte fut appuyé par les questions orales avec débat déposées par les sénateurs Félix CICCOLINI, sénateur socialiste des Bouches-du-Rhône, Francis PALMERO, sénateur centriste des Alpes-Maritimes et Charles LEDERMAN, sénateur communiste du Val-de-Marne.
Des universitaires et des magistrats publièrent à leur tour des opinions divergentes tandis que le Président Alain POHER organisait, avec le sénateur Henri CAILLAVET, un colloque portant sur l’informatique et la société, en partenariat avec l’Association des libertés. Au cœur des débats engagés par les députés figurent la protection de la liberté individuelle et de la vie privée ainsi que les usages de l’informatique. Les travaux se poursuivent, à compter d’octobre 1977, au Sénat.
Le législateur doit résoudre une équation à plusieurs inconnues. « Devant nous se profile une évolution fantastique et encore imprévisible aujourd’hui, moins sur le plan technologique que, peut-être, sur celui de ses conséquences psychologiques et sociologiques. ». La loi doit protéger « chaque citoyen » tout en étant visionnaire, sans aller vers la dystopie. « Plus loin encore, en matière culturelle par exemple ou de l’information, le rôle de l’informatique peut devenir capital, il suffira de posséder un téléphone à clavier et un poste de télévision pour pouvoir, chez soi, interroger les bandes de données les plus sophistiquées. »
Dans son rapport, le sénateur THYRAUD souligne l’une des principales difficultés, à savoir que « l’informatique a […] introduit une capacité de mémorisation considérable au point que certains peuvent craindre qu’elle ne porte atteinte à l’un des droits les plus fondamentaux de l’être humain : le droit à l’oubli. » Ce n’est pas tant la nature du fichier que son support qui préoccupe le législateur, l’accès à l’information étant plus rapide et centralisé.
La commission des Lois du Sénat propose d’instituer plusieurs principes pour réguler les pratiques :
– les traitements automatisés des fichiers publics contenant des informations nominatives doivent être prévus par des actes réglementaires et déclarés obligatoirement auprès de la commission informatique et libertés : Il s’agit d’interdire de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes ;
– la destruction des informations contenues dans les bases doit être programmée dès leur création ;
– un droit d’accès aux informations nominatives est créé ;
– enfin les données d’ordre judiciaire, médical et des domaines de la sûreté d’État et de la Défense font l’objet d’une protection spécifique.
La commission des Lois du Sénat revoit en profondeur la composition et le fonctionnement de la commission informatique et libertés en lui conférant une plus grande indépendance. Ses membres sont magistrats, parlementaires, conseillers économiques et sociaux, avocats, journalistes, professeurs, ou personnalités qualifiées.
Le sénateur THYRAUD observe également, dès 1977, que la loi nationale ne doit pas freiner l’utilisation de l’informatique à l’international car « un excès de protection pourrait être en effet de nature à pénaliser notre pays tant au niveau de la fabrication que de l’utilisation des ordinateurs ». Il se déclare « très favorable à l’élaboration d’une convention internationale qui puisse protéger efficacement les libertés face au développement impressionnant des télécommunications. ». De fait, la loi de 1978 a été révisée en 2016, pour y intégrer la dimension européenne de la gestion du traitement des données, par le biais du règlement général sur la protection des données (2016/679 du 27 avril 2016).
La commission des Lois du Sénat constate, à la même époque, que l’informatique documentaire rattrape l’informatique de gestion, qui se développe aussi au Parlement où, depuis janvier 1975, les deux assemblées créent des bases de données, notamment pour la gestion documentaire des questions écrites ou orales des parlementaires.
L’implantation de l’informatique documentaire au Sénat est réalisée dès 1977 et se poursuit aujourd’hui puisque l’intelligence artificielle est d’ores et déjà intégrée dans certains processus.